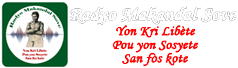Haïti : Transition post duvalierienne. Entre démocratisation et chimérisation. L’échec d’une génération
Written by Papi Zo on November 21, 2024
Papi Zo
Temps d’écoute : 24 minutes :
 Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres (Gramsci)
Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres (Gramsci)
« La critique de la politique se définit par le refus de la sociologie politique [qui], prétendant édifier une science du politique, tend à faire de la politique une science ; par le choix d’un point de vue : écrire sur la politique du côté des dominés, de ceux d’en bas pour qui l’état d’exception est la règle ; par l’interrogation fondamentale formulée par La Boétie : pourquoi la majorité des dominés ne se révolte-t-elle pas ? » (Miguel Abensour).
“ Ils ne sont pas humains. Un être humain ne vivrait pas comme eux.
Un être humain ne pourrait pas supporter d’être aussi sale et malheureux”
John STEINBECK
Les raisins de la colère
Ce texte entend contribuer à débroussailler un écheveau d’interrogations suscitées par l’impasse de la transition démocratique en Haïti. Sans prétention à l’exhaustivité et moins encore à mettre fin à un débat qui, pour s’être révélé interminable, n’a fait qu’ajouter à la complexité au lieu de l’éclairer, on se laissera de préférence guider par le souci de simplification en évitant toutefois de tomber dans la facilité de réponses expéditives non argumentées.
Analyser les causes de l’échec de la transition paraîtrait trop ambitieux. Par contre partager quelques réflexions utiles à un éclairage des questions suscitées par cette longue nuit d’incertitudes sur laquelle a trébuché l’ambitieux projet, largement sous-estimé, de sortir de la dictature, nous semble suffisamment laborieux et souhaitons-le utile :
• Du climat social d’aujourd’hui à celui du règne des tontons macoutes, lequel serait plus enviable ?
• Existe-il un lien de causalité entre la chute de la dictature et le chaos actuel ?
• Le mouvement social de 1986 portait-il en germe les éléments de sa dégénérescence ?
• Quelles élites pour quel État de droit ?
• En quoi la politique américaine caractérisée par la peur de la démocratie est-elle au centre de l’échec de la transition démocratique ?
Depuis quelques années un spectre hideux, plus macabre que les précédents, hante le pays haïtien : l’emprise des gangs sur le monde vécu individuel et collectif. Moins intéressé à dérouler les chiffres des dégâts matériels, psychologiques et sociaux d’une dizaine d’années de violence indiscriminée sur la population civile, il nous importe d’oser penser ce phénomène qui présente justement la caractéristique d’entrainer une sorte de psychose générale à effet de suspendre toute réflexion rationnelle, avec le souci d’éviter tout amalgame entre expliquer et justifier, joint à la certitude que le refus de comprendre est une abdication à l’action juste.
La tension classique entre liberté et sécurité se présente à l’occasion sous un mode paradoxal. En effet, en l’espèce, il ne s’agit point d’opérer un choix qui se révèlerait difficile, puisque l’insécurité se présente en négation de la liberté en tant que principe existentiel, mais aussi des libertés citoyennes. Tous les droits humains, celui à la vie, à circuler librement, à disposer en toute autonomie de son corps, droits d’association, de participation à la vie civique, sont mis en pause, suspendus à l’arbitraire de chefs de bandes incontrôlés, confondus avec les pouvoirs publics en déliquescence. Même les frontières entre vie publique et privée sont subitement dissoutes, brouillant celles déjà fines entre la vie et la mort, apparentant ce pouvoir criminel diffus aux pires expressions du totalitarisme.
Si ce désastre de nature anthropique paraît se situer par son ampleur et sa proximité chronologique dans la continuité de la catastrophe socio-naturelle du 12 janvier, ses racines remonteraient un peu plus loin. Quoiqu’en réalité leurs causes sont, à regarder de plus près, assez solidaires. Mais pour la commodité d’une référence historique facilement observable, arrêtons-nous à la dérive dictatoriale de Duvalier, son impact crépusculaire sur le vieux modèle autoritaire haïtien, avec ses mécanismes violents de contrôle politique et sa continuité amplifiée dans le contexte dit de transition démocratique. A ce titre, on pourrait céder à la tentation de la facilité, pour simplement voir en nos gangs une détérioration du modèle type des corps des tontons macoutes. Les raisons de cette réception empirée de ce qu’il fallait dépasser, Michel Rolph Trouillot [1] de façon prémonitoire avait annoncé le pourquoi et le comment dans son incontournable « Racines Historiques ». C’est bien en analysant la structure du pouvoir, telle que dessinée par les pères fondateurs, que l’intelligibilité des origines de la gangstérisation actuelle de la vie publique peut se dévoiler. Non point au sens d’établir une équivalence entre les principes et les mobiles d’action de nos ancêtres avec ceux des protagonistes successifs, mais plutôt de voir en quoi leur aboutissement actuel est le fruit d’un long processus de dégénérescence du modèle initial.
Avec le recul historique, il s’évidente que l’échec d’une sortie par le haut du duvaliérisme ne pouvait ne pas aboutir à une amplification de sa monstruosité. En tant qu’il est la synthèse, le condensé des pulsions autoritaires du pouvoir affranchi, en l’absence d’une reconfiguration de l’alliance de classe régnante, le système ne pouvait que poursuivre sa lente agonie, en laissant échapper toute sa puanteur cadavérique.
A chaque carrefour raté, un nouvel abysse se creuse dans le fond des abimes, prête à engloutir les impudents naufragés. Il y a des sorties qui sont des labyrinthes, se reproduisant chaque fois que l’on reprend les modes opératoires de ce que l’on prétend combattre. Quand de nouvelles fins sont alignées sur des moyens qui trahissent le souci d’une nouvelle éthique, on ne fait que reproduire les conditions de pérennisation de l’ancien. L’histoire est têtue et impitoyable dans ses leçons. Nous en faisons aujourd’hui l’amère expérience. Il n’est pire égarement que de s’attendre à des résultats différents, en répétant les mêmes erreurs. De même que le Pè Lebrun a assuré la reproduction fantomatique empirée du macoutisme, l’apologie du Bwa Kale annonçait déjà l’intronisation de la perfidie corruptrice au sommet du pouvoir déliquescent.
Ce que l’odeur du Pè Lebrun est à la puanteur du bwa kale
Qu’en est-il du pouvoir de la bête une fois que la foule dans son déchainement, à sa chute, a cru bon de déguster sa chair calcinée ? Diffusé comme un virus dans l’organisme social, il semble en se dissolvant provoquer une forme de maladie dégénérative qui, au lieu de tuer, entraine une lente et interminable agonie, avec des accès de souffrance et de douleur, qui portent individus et collectifs à des comportements insolites d’autodestruction. Seule une micro physique de la violence suicidaire, serait à même de rendre compte de la dynamique d’anomie qui engloutit inexorablement tout espoir de relèvement sociétal en Haïti, depuis bientôt près de trois décennies. Il en est que, tel atteint de ce mal du pouvoir qui exacerbe en une intensité non maitrisable nos pulsions au mal, le corps social dans toutes ses composantes et ses divers champs, se complait à reproduire à satiété les formes les plus régressives et dégradantes d’expression relationnelle. Tout se passe comme si l’énergie qui nourrissait dans un élan démocratique, l’utopie d’une sortie exceptionnelle de la dictature, à la hauteur du miracle haïtien, a été déviée en une passion morbide pour une course effrénée vers l’abime. Un état/Etat d’aplatissement général des consciences et de l’agir est promu en lieu et place du relèvement nécessaire, qu’accompagne toute phase transitionnelle. Ce qui demeurait concentré dans le cercle fermé du pouvoir autocratique, en termes d’horreurs, de stupidités et de vices, se repend et est revendiqué au grand jour, du plus bas au plus haut de l’échelle sociale. Une démocratisation de la bêtise, le droit égal pour tous de se vautrer dans l’obscénité, la glorification du vice. En cela seul se justifie une certaine nostalgie de la dictature, qu’elle revendiquait et exerçait le monopole de la laideur légitime. Ce qui prévenait d’un débordement généralisé des pulsions collectives et individuelles iatrogènes, dans l’espace public.
Ces expressions provoquées et refoulées sous la dictature, puis lâchées par sa chute, irriguent les micro-pouvoirs qui circulent dans la société, produisant une ’explosion de violence physique, verbale, symbolique, emportant dans ses débordements les capacités institutionnelles de régulation de l’État failli. On est comme en présence d’une capture et d’une reproduction systématique au niveau micro, des pratiques, comportements et des désirs, du pouvoir dictatorial. L’alternance, l’ouverture à tous et à chacun du droit à la corruption, l’universalisation de la m. bref la bamboche démocratique. Cette libéralisation des libéralités que se réservait la ploutocratie duvaliérienne, ne s’accompagne pas moins d’une quête acharnée de monopole. D’autant que « l’invasion des ONG » qui a permis une redistribution éclatée de l’aide internationale, parallèlement à l’ouverture de certains champs de pouvoir symbolique, a provoqué des luttes de classement qui ne rechignent pas à mobiliser les mêmes stratégies reprochées à la dictature.
Cet éclatement du Pouvoir, accentué par la privatisation de l’État, a paradoxalement pour effet la confusion des sphères publique et privée. Le droit de punir ainsi que le monopole de la violence légitime, tend à être récupéré, et mis au service de la lutte des places, substituée à celle des classes. Les conflits, sans lieu d’arbitrage éclatent de partout, pour accéder aux champs ou à l’intérieur de ceux-ci, en guise de mobilité ascendante. Étant donné qu’il en résulte que les mécanismes démocratiques sont aussi, sinon plus enrayés que dans l’espace politique, le recours à des manœuvres déloyales, et perverses jusqu’à l’instrumentalisation de la colère des subalternes, devient la règle. Ainsi est transposé dans le civil, le fonctionnement de l’autoritarisme étatique, avec tout ce qu’il renferme de germes et de pratiques de corruption. Il en est ainsi, parce que les relations de pouvoir ordinaires dans la société sont investies par des pouvoirs qui échappent à leur mécanisme interne de régulation, sans possibilité de recours efficace à une autorité légitime. L’énergie de révolte des marginalisés est muée en réservoir de violence au service des multiples causes individuelles qui informent les luttes de classement.
Sweet power
La plus pertinente illustration de cette course effrénée vers la dégénérescence totale, est l’avènement du SWEET POWER, en tant qu’il revendique le surcodage des manifestations les plus perverses de la bêtise humaine en cours dans les relations sociales. Mais s’il est arrivé à en faire un mécanisme de pouvoir jusqu’à capturer l’appareil d’État en décomposition cadavérique, il n’a pas l’exclusivité de cette dérive.
La confusion entre chimère et populaire relève du même registre de perte de sens qui pousse à se rabattre, par effritement des valeurs de gauche, sur des expressions désespérées et perverties des frustrations des subalternes, pour accéder à des espaces de pouvoir. Ainsi, à défaut de l’accession à une conscience de classe qui transformerait l’énergie de révolte des exclus en un projet alternatif à la barbarie de la domination capitaliste périphérique, celle-ci est instrumentalisée, cooptée , dans les stratégies de lutte de placement. Il en résulte que les micro- conflits intra sociétaux mobilisent plus d’énergie de destruction, que ceux opposant les catégories marginalisées à l’appareil d’État. L’idéologie des droits de l’homme aidant, il devient moins dangereux d’investir l’arène politique pour s’opposer aux dirigeants du moment, que de ferrailler dans les divers champs où les conflits de pouvoir gagnent de plus en plus en intensité.
Olye m mouri malere m pito mouri jenn gason [2]
« Ceux-là peuvent encore rêver des bienfaits de la modernité, ceux-ci vivent au contraire dans la désillusion la plus totale, leur espérance n’est plus devant mais derrière eux. »
Avec l’effritement du système traditionnel sous l’effet de la globalisation capitaliste, cette situation d’anomie généralisée, va se traduire par une explosion de violence dans les bidonvilles. Structurée en fragments, elle est devenue le système de réponse éphémère à l’exclusion sociale, devant la rupture des mécanismes de survie mis en place dans le monde rural et péri urbain. Ce sont fondamentalement les effets pervers de la modernité capitaliste en situation de précarité socio-économique. Cette réponse régressive doit donc être appréhendée comme manifestation d’un phénomène structurel à multiples dimensions, à la fois économique, sociale, culturelle et politique. La globalisation a produit une désarticulation des modes de production. Le rôle de reproduction à bons frais de la force de travail, joué au paravent par les systèmes non capitalistes, a été rompu, tandis que l’absence de modernisation industrielle ne permet pas d’intégrer cette vague de population livrée à elle-même. Il y a donc déstructuration du monde rural, sans contre partie en aménagement d’une vie urbaine adéquate. Ce phénomène se constate à tous les niveaux, non seulement sur le plan économique, matériel mais aussi sur celui des valeurs. D’où une véritable perte de sens dans une société désarticulée, désorientée, chimérisée, finalement gangrénée, qui n’est plus que l’ombre d’elle-même.
De L’État RESTAVEK à L’État ZOMBI
Avant son total effondrement, à la faveur de la catastrophe du 12 janvier 2010, les demandes sociales s’adressaient moins à l’état-restavèk que directement au pouvoir transnational, qui à travers les ONG et autres institutions imposent des réponses déstructurant à la fois de la société et de l’État. Auparavant, la société traditionnelle répondait à ses besoins par ses propres mécanismes et évitait au contraire d’inviter l’État subalterne à s’ingérer dans l’organisation de son mode de vie, afin d’échapper à ses mécanismes de prédation. Même les indispensables services de sécurité et de justice, attributs draconiens du pouvoir public, étaient de préférence assurés par des sociétés secrètes. C’est pourquoi les mouvements de revendications populaires sont restés historiquement très limitées, et ne seront significatifs qu’avec l’émergence des foyers populaires urbains. On a pris l’habitude de répéter avec une connotation négative, que les Haïtiens se mobilisent généralement contre, mais pas pour quelque chose. Cela s’explique par le fait que la dynamique populaire se structurait selon une logique d’autonomisation radicale, sur base d’un choix civilisationnel de la simplicité, en limitant le plus possible ses besoins. Elle ne réagit donc que face aux menaces externes à son fonctionnement autonome et auto dynamique. Ses demandes et ses revendications, elle se les formule à elle-même et pour elle-même, en les minimisant, pour y apporter les réponses les plus simples, les moins coûteuses, les plus ingénieuses et les mieux appropriées.
L’État, n’étant pas celui de la société, est vécu comme un corps étranger auquel on doit payer tribut pour éviter ses tentacules prédateurs. C’est le diable, le mal absolu qu’on doit contourner le mieux qu’on peut. C’est l’héritier du pouvoir colonial à peine coloré, même masqué en noir et rouge, qui fait la chasse aux libertés, à la Liberté. Sa fonction est d’empêcher la nation de se constituer tout en assurant un fonctionnement social a minima . Se libérer c’est vivre loin de l’État, hors de l’État, sans l’État, en toute autonomie, en autosuffisance. L’attitude du paysan vis-à-vis des services publics témoigne jusqu’à présent de cette vision des choses. Les infrastructures publiques en milieu rural , étaient perçues plus comme une intrusion non souhaitée que comme un apport à l’amélioration de la qualité de vie. Puis elles devinrent, l’idéologie parasitaire du cash for work aidant, occasion de maintenir sous perfusion une population asphyxiée sous l’emprise des mesures d’ajustement structurel. Inutile d’avancer qu’il n’y a pas eu appropriation par la communauté de ces types d’interventions.
Avec la globalisation une nouvelle étape est franchie, qui voit l’État vidé de toute fonction distributive et sa souveraineté réduite en peau de chagrin, au nom de la privatisation des entreprises publiques sous prétexte d’inefficacité techno administrative et de libéralisation économique. Le consensus de Washington entérine une nouvelle division internationale du travail et l’ouverture des territoires au déferlement du néo libéralisme. Le marché remplace l’État et les populations périphériques, là où ils sont défaillants, sont livrées à une compétition féroce pour la survie du plus apte. Dans cette conférence de Berlin d’un genre inédit, qui fait la part de territoire, donc de marché, laissée à la criminalité internationale pour ses mérites financiers et surtout les précieux services rendus à l’occasion de la féroce compétition bipolaire. Toujours est il que l’État s’est réveillé un bon matin de 1994, en plein consensus de Washington, sans aucune force légale pour se donner l’air d’assurer sa souveraineté intérieure. Il se révèle, avec le recul du temps, que dans la foulée du déchoucage de la milice macoute, l’agenda impérial du passage de la domestication de l’État à sa zombification, contenait bien le démantèlement de l’armée. Selon le principe qui veut que le vide soit comblé par celui qui le fait, surgirent « spontanément » du laboratoire, toutes sortes de substitut : des armées cannibales à celle des 103 zombis en passant par les 509 fantômes, les centaines de mawozo, sans compter les diverses Kokorat san ras, les rats constipés (Rat pa kaka) et autres rongeurs plus ou moins affamés revendiquant leur place sur la table des grands mangeurs. Expression manifeste du degré d’éclatement du monopole de la violence légitime marquant l’effondrement du politique, l’Etat de droit qui n’a jamais pris céda le pas à l’État bandit .
Instrumentalisation de l’insécurité criminelle
Pourquoi le phénomène des gangs constitue une grille de lecture pertinente de l’effondrement social et étatique, sans être la cause de ce double effondrement ? En d’autres termes, pourquoi faut-il récuser le cadre explicatif tendant à ramener la crise au phénomène de l’insécurité, attribué au fait exclusif de l’action des gangs, et l’adopter comme point de départ d’une appréhension approfondie de la dégénérescence crépusculaire de la formation sociale post coloniale affranchie ?
Il s’agit en effet de dévoiler l’instrumentalisation idéologico politique d’un phénomène social, pour camoufler la réalité de la double domination interne et externe des classes dirigeantes locales et internationales sur l’ensemble de la formation sociale haïtienne. D’un même mouvement de pensée, l’analyse du discours des acteurs, au-delà de sa fonction de légitimation de ce qui paraît à première vue injustifiable, permet de rendre raison de son ancrage historique et d’un certain substrat contestataire de l’ordre établi.
Le focus mis sur les gangs, en faisant du banditisme un phénomène local et localisé, spontanément surgit des bidonvilles, a pour effet d’obscurcir à la fois la cause du phénomène lui-même, pris isolément, et celles de l’effondrement du système néocolonial affranchi. La violence systémique de l’apartheid post colonial, au service de la domination impérialiste, se trouve obscurcie par effet d’écran de celle des bandits, exacerbée à dessin. L’économie criminelle transnationale, à travers laquelle se réalise l’insertion subalterne d’Haïti dans l’ordre néolibéral, disparait quasi totalement du radar, comme fondement matériel de la gangstérisation du pouvoir politique. Or l’intrusion hégémonique de l’empire dans la structuration du pouvoir affranchi à partir de 1825, consolidée de manière irréversible depuis 1915, est le principal facteur de sa dégénérescence monstrueuse autophagique.
La dissociation du phénomène des gangs armés de l’économie criminelle transnationale organisée, sert à isoler la crise multidimensionnelle haïtienne de ses causes structurelles, liées fondamentalement au mode d’ajustement du pays au nouvel ordre mondial libéral. Pointe émergée à dessein de l’iceberg de l’intégration néocoloniale d’un espace périphérique à l’ère de la globalisation libérale, l’insécurité criminelle organisée permet de couvrir la structure transnationale de la domination, ainsi que l’articulation asymétrique des causes internes et externes du drame national.
Malgré l’implication avérée des gros bonnets de la drogue et de la finance criminelle dans le financement des bandes armées et l’articulation non moins manifeste de leurs actions avec toutes sortes de traités illicites, le narratif sur l’insécurité tient à présenter celle-ci comme le fait exclusif des va-nu-pieds des ghettos. Ce qui a pour fonction idéologique de couvrir les causes profondes des inégalités sociales sous le vieux manteau du désordre atavique haïtien, et disculper, du coup, la domination de type colonial de toute responsabilité dans la débâcle nationale. Au service d’une cause qui les dépasse, poussés par la misère et attirés par les attraits de la société de consommation, les déshérités des ghettos se laissent métamorphoser en criminels à sapat. A la rencontre de ses promesses non tenues, ils s’arment des ingrédients les plus régressifs de la tradition, pour forcer les portes de la modernité. A l’intersection des enfers et des cimetières, ils assument leur état de zombi, pour réclamer leur part du festin des vautours et hanter, en fantômes cannibales, les sommeils et les siestes des « gens de bien. »
Quoiqu’inconscients de leur fonction dans le répertoire impérial, ils ne l’assument pas moins avec efficacité, en faisant de la population misérable, la destinataire prioritaire de leur violence. Car il importe avant tout d’aiguiser les contradictions au sein du peuple, pour noyer, dans un brouillard de sang, la réalité des inégalités sociales et de ses causes structurelles. Et du même coup de dégager de toute responsabilité, la répartition inégale des richesses du monde et les conséquences sur les plus pauvres des dégâts causés à la planète par les nantis. Ainsi l’empire se conforte-t-il dans son rôle d’arbitre de nos malheurs, au point de trouver l’aisance de se faire promoteur d’une solution haïtienne à la crise. Nos souverainistes de salon y trouvent du grain à moudre pour endormir leur conscience nationaliste autrement endolorie. La sollicitude impériale va jusqu’à fournir son appui musclé, désintéressé bien sûr, à cette réponse « souveraine » des haïtiens contre les haïtiens, au désastre qui les engloutit tous. Car l’insécurité a pour surcroit de vertu d’installer la nation dans une guerre civile hybride larvée que seule peut débloquer l’intervention de forces internationales.
Le souffle du pays est suspendu en l’attente du sauveur étranger qui viendra le débarrasser de ses démons intérieurs, commandités par un stratège extraterrestre, qui les entretient en armes et en finances. On ne s’étonnera guère que le sauveur ne s’empresse pas de satisfaire les vœux de ses subordonnés en souffrance, embarrassé qu’il est de devoir décevoir ses supplétifs armés, chargés d’administrer le châtiment à leurs frères ennemis.
Les Haïtiens tardent à accepter que la fin de l’ère bipolaire a emporté le besoin d’État pour leur pays devenu une colonie pénitentiaire sous la férule de commandeurs modernes.
* Chercheur
(À suivre : Les gangs bras armé du soft power : l’avènement de la démocratie criminelle)
[1] Michel Rolph Trouillot : Les Racines Historiques de l’Etat Duvaliérien.
[2] Ultime alternative au ‘’pito nou led nou la’’
 Radyo Makandal Sove
Radyo Makandal Sove