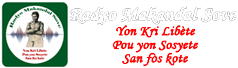MISÈRE DE LA DÉMOCRATIE – DÉMOCRATIE DE LA MISÈRE
Written by Radyo Makandal Sove on December 6, 2024
II – LA DÉMOCRATIE MONDIALISÉE LAVE PLUS BLANC.
Depuis la chute du Mur et la fin des dictatures de l’Est, la mafia semble aller de mieux en mieux. Aurait-elle “besoin” de la démocratie pour prospérer ? 1
Des signes de vieillissement de l’empire.
 À la manière d’un dirigeant de république bananière, à la tête de la plus grande puissance militaire de tous les temps, un vieillard s’accroche désespérément au pouvoir. Sa seule chance de vaincre son trublion d’adversaire à peine moins décrépi est de contourner les urnes pour le jeter en prison. La justice en démocratie constitue parfois, de plus en plus même, un recours efficace contre un verdict populaire imprévisible. Anticiper un éventuel mauvais vote du peuple, quoi de plus démocratique que de faire jouer l’équilibre des pouvoirs à l’encontre de la tendance des urnes diagnostiquée par la magie des sondages.
À la manière d’un dirigeant de république bananière, à la tête de la plus grande puissance militaire de tous les temps, un vieillard s’accroche désespérément au pouvoir. Sa seule chance de vaincre son trublion d’adversaire à peine moins décrépi est de contourner les urnes pour le jeter en prison. La justice en démocratie constitue parfois, de plus en plus même, un recours efficace contre un verdict populaire imprévisible. Anticiper un éventuel mauvais vote du peuple, quoi de plus démocratique que de faire jouer l’équilibre des pouvoirs à l’encontre de la tendance des urnes diagnostiquée par la magie des sondages.
En périphérie du système monde, de pareilles pratiques mobiliseraient les commissaires en droit de l’homme au titre de persécution politique ou autres violations de la liberté. L’âge avancé des prétendants au trône de l’empire, en témoignage de son inéluctable déclin, n’est donc pas le seul trait commun avec les gérontocraties du tiers-monde. L’élimination extra-électorale de compétiteurs politiques en est un autre encore plus significatif. En outre deux élections majeures aux États-Unis, la plus puissante démocratie du monde, nous ont appris que désormais la contestation du verdict électoral n’est plus l’apanage de nostalgiques régimes autoritaires ou de mauvais perdants élèves du NDI2.
Du train où vont les tensions pré-électorales à mesure que l’on s’approche de l’échéance fatidique, d’aucuns préconisent avec un brin de malice l’envoi d’observateurs internationaux pour éviter l’explosion du système américain. De même, la manipulation des institutions de l’appareil administratif de l’Etat s’est révélée avoir plus de poids que le vote du citoyen. Ainsi a-t-on découvert à l’occasion que le contrôle du service postal constituait un atout majeur au point que le combat pour le choix de directeur général de cette institution fut au coeur de l’enjeu électoral. D’autres mécanismes encore plus directs ou autrement subtils telles les modalités du scrutin, le type de découpage des circonscriptions, le mode de dévolution des sièges etc. interviennent pour brouiller la sincérité du scrutin et la fiabilité du système dans son ensemble.
Sans devoir recourir aux pertinents constats d’Adam Pzeworski, « l’avènement des élections dans nos systèmes politiques relève d’une stratégie fructueuse d’adaptation des puissants pour se maintenir au pouvoir face à la pression de la souveraineté populaire, et non de la volonté des gouvernants de mettre en oeuvre la démocratie ». Il en veut pour preuve que les élections ont le plus souvent porté au pouvoir des personnalités déjà dominantes socialement.
Le spectacle des compétitions séniles pour ou contre le “Great again” d’un empire crépusculaire invite à mieux aborder ce que l’on présente en panacée universelle du meilleur gouvernement des hommes en toutes circonstances. La vertu3 axiale supposée des élections évoquées pour contre balancer ses multiples faiblesses épistémiques, qui serait d’assurer la paix civile, l’assaut du capitole l’a fortement entamée. Là encore le modèle reste semblable à ses avatars dits sous développés qui ont tous du mal à vérifier cette qualité axiomatique. Au point que les quelques joutes électorales qui se déroulent et se concluent dans la paix sont brandies comme d’heureuses exceptions. En fin de compte le vieux Biden poussé à la sortie, après une piteuse performance lors du fameux débat télévisé suivi d’une tentative ratée d’assassinat de son adversaire, tenta un dernier coup d’autocrate gâteux en désignant lui-même son successeur.
Dans cette dynamique de confluence centre/périphérie certains pays restent enfermés dans une boucle de rétroaction positive paradoxale, malgré leur proximité du noyau de l’empire ; on les appelle les périphéries délaissées. Ils subissent tous les dommages directs et collatéraux de la mondialisation sans retombée positive en retour. Haïti fait partie de ceux-là.
L’extrême périphérie trop près du centre, entre démocratie pèpè et argent sale
lls sont illettrés, ils n’ont pas de travail, ils sont inutiles, n’ont pas de chien à bastonner, pas de femme à battre, pas de patron dont ils pourraient déchirer la chemise. Ils ne servent à rien, et le savent. Alors toute la violence qui est en eux, pour peu qu’on leur dise quoi en faire, ne demande qu’à exploser.4
 A l’extrême périphérie de l’empire, un pays situé à son voisinage immédiat dit à sa façon l’effondrement de notre monde. La démocratie y suit la courbe inversée de la misère, tandis que l’une ne cesse d’augmenter jusqu’à toucher le fond de l’infrahumain, l’autre n’a jamais pris, adoptant de préférence les traits grimaçants de la perversion de ses principes.
A l’extrême périphérie de l’empire, un pays situé à son voisinage immédiat dit à sa façon l’effondrement de notre monde. La démocratie y suit la courbe inversée de la misère, tandis que l’une ne cesse d’augmenter jusqu’à toucher le fond de l’infrahumain, l’autre n’a jamais pris, adoptant de préférence les traits grimaçants de la perversion de ses principes.
La communauté internationale a réussi le tour de force d’installer de manière durable la violence armée dans l’espace public haïtien. Mieux, elle en a fait un élément incontournable du fonctionnement de sa démocratie. A sa manière il faut le reconnaître, elle assure ainsi une forme d’intégration des exclus dans le jeu politique. Désormais, l’appareil d’Etat devient le prolongement d’un réseau éclaté de pouvoir avec lequel il négocie son monopole de violence légitime, et dans une mesure de plus en plus certaine, sa fonction distributive. Le concept de bandit légal ou d’Etat bandit, traduit lumineusement cette réalité, à condition de ne pas le limiter à un emploi partisan. Ce qui aurait pour inconvénient de restreindre sa portée explicative et sa puissance de suggestion ; car il concerne le fonctionnement général du pouvoir, en démocratie « pèpè ». Du moins tel qu’elle est expérimentée en ce coin extrême de la périphérie du système mondial, en cure forcée de libéralisation.
Le crime et le marché main dans la main
Avec ses 870 milliards de dollars générés chaque année selon les estimations de l’ONU en 2009, la part de la criminalité transnationale organisée dans l’économie mondiale équivaut à plus de six fois le montant de l’aide au développement, ou 7 % de l’exportation globale de marchandises. Chaque année, d’innombrables personnes perdent la vie à cause de la criminalité organisée. Les principales raisons en sont les problèmes de santé liés à la drogue, la violence, les morts par armes à feu, les méthodes et les motivations peu scrupuleuses des trafiquants d’êtres humains et de migrants. Cette tendance, en constante évolution, marche au rythme de la mondialisation dont à la fois elle profite de l’expansion et participe de la dynamisation. C’est une économie qui s’adapte aux marchés et génère sans cesse de nouvelles formes de délinquance. « La mondialisation est “criminogène”, ce qui veut dire qu’elle est propice aux pratiques criminelles, notamment grâce à ses instruments de dissimulation (paradis fiscaux, trusts, sociétés-écrans, etc.). Malgré une législation toujours plus sourcilleuse, il est aisé, pour les élites globalisées – légales ou criminelles – de se jouer des règles de droit. »5 . Il s’agit d’un commerce illicite qui ne connaît pas de frontières, transcende les barrières culturelles, sociales, linguistiques et géographiques, transgressant toute limite normative et ignorant les règles. Sa pénétration dans toutes les sphères de la vie rend difficile de bien mesurer sa véritable portée et l’ampleur de ses impacts politiques et économiques. Trafic en tous genres, de drogue, d’organes, de migrants, blanchiment d’argent, commerce d’armes à feu, trafic de contrefaçons, trafic d’animaux sauvages, traite des êtres humain, trafic de biens culturels, la cybercriminalité sont autant d’activités de la criminalité transnationale organisée. Inutile de dire que les conséquences sont incommensurables en termes de déséquilibre individuel et collectif. L’importance économique de la criminalité transnationale n’est donc plus à démontrer. Ce qui reste obscurci par contre, c’est son instrumentalisation en arme géostratégique et en dispositif de contrôle politique à la fois à travers les guerres hybrides entre les grandes puissances et la mise sous contrôle des souverainetés périphériques. Et surtout la concordance entre les deux mains invisibles de la démocratie libérale, le marché et le crime transnational. Dans le contexte post-guerre froide, avec l’expansion du modèle de démocratie électorale, apparaissent deux modalités de la capture de l’Etat par ce qu’on appelle l’argent sale : d’une part la corruption du choix des dirigeants au centre, et de l’autre la capture de l’Etat dans les souverainetés déliquescentes.
Haïti monnaie d’échange d’une transaction transnationale mafieuse ?
Le très officiel commissaire général de la police française Jean-Francois Gayraud soutient dans un entretien sur son retentissant ouvrage « La mafia et la Maison-Blanche » ce qui suit : « De Franklin D. Roosevelt à Joe Biden, une dizaine de Présidents des États-Unis ont entretenu des liens très douteux, voire de pure collusion, avec la Mafia Italo-américaine. Ces présidents appartiennent aussi bien au Parti Démocrate (Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson, Clinton, Obama, Biden) qu’au Parti Républicain (Nixon, Reagan, Trump). Les formes et l’intensité de ces relations diffèrent d’un président à l’autre. Certains présidents ont été simplement compromis, d’autres peuvent être qualifiés, sans exagération, de “mafieux”, tant la relation avec la Mafia fut symbiotique, à l‘image de Richard Nixon. » Il ajoute « nous sommes en présence de deux super puissances, l’une politique, économique et militaire, l’autre criminelle, et toutes deux sont exceptionnelles par leur force et leur longévité.6.
 Éloigné du « Bondieu » et trop près des États-Unis, à coups d’ajustement, Haïti a été entrainé par le bas et intégré sur les marges de la mondialisation en devenant une plaque tournante des flux de trafics illicites partant de la cordière des Andes au centre de l’empire. Suivant la logique de la globalisation libérale, le commerce illicite préfère à la présence pesante de l’Etat l’invisibilité de la main du marché. Non point qu’il vise nécessairement sa disparition mais de préférence son affaiblissement à fin de cooptation. Moins que l’appareil, l’attribut de souveraineté dont il prétend se réclamer à l’intérieur de frontières internationalement reconnues, constitue l’obstacle à éliminer pour réaliser la libre circulation illicite de biens, de personnes de préférence en pièces détachées.
Éloigné du « Bondieu » et trop près des États-Unis, à coups d’ajustement, Haïti a été entrainé par le bas et intégré sur les marges de la mondialisation en devenant une plaque tournante des flux de trafics illicites partant de la cordière des Andes au centre de l’empire. Suivant la logique de la globalisation libérale, le commerce illicite préfère à la présence pesante de l’Etat l’invisibilité de la main du marché. Non point qu’il vise nécessairement sa disparition mais de préférence son affaiblissement à fin de cooptation. Moins que l’appareil, l’attribut de souveraineté dont il prétend se réclamer à l’intérieur de frontières internationalement reconnues, constitue l’obstacle à éliminer pour réaliser la libre circulation illicite de biens, de personnes de préférence en pièces détachées.
Les pays à souveraineté affaiblie par la déferlante néolibérale globalisée, situés sur la trajectoire du trafic illicite du Sud vers le pôle industrialisé, voient leur territoire servir de monnaie d’échange dans les transactions entre le secteur mafieux et les dirigeants politiques arrivés au pouvoir grâce aux financements occultes. Au Nord les trafiquants négocient leur part du marché mondial en finançant les décideurs et en infiltrant les appareils de sécurité. En périphérie utile ils s’en accaparent tout simplement. Là ils influencent et participent à la sélection des gouvernants. Ici ils capturent totalement l’Etat. Ce partage se réalise par le biais de négociations où sont sauvegardés les objectifs de puissance de l’empire articulés aux intérêts financiers du secteur mafieux.
Lire dans le noir
L’aveuglement idéologique consiste à les faire considérer comme deux pôles opposés en conflit permanent. Ou encore à voir dans les activités criminelles locales une entreprise sui generis dont les acteurs jouissent d’une parfaite indépendance ou autonomie. L’analyse conduit à obscurcir la réalité qui s’avise à détacher l’économie criminelle de l’économie formelle, et prétendre à des réponses internes à un problème transnational. Les effets de ce piège idéologique sont très fâcheux sur la capacité à rendre intelligible aux victimes la situation d’insécurité systémique qu’ils subissent. La résolution du conseil de sécurité des Nations-Unies sur l’envoi d’une Mission Multinationale d’Appui à la Sécurité, (MMAS) en Haïti en réponse à la criminalisation du pays s’inscrit en droite ligne de ce brouillage cognitif. Les Haïtiens sont invités, par cette haute instance de la gouvernance mondiale, à voir dans la descente du pays aux enfers une simple affaire de bandits armés qu’il suffirait de neutraliser en éliminant tels chefs dont la tête est mise à prix. Avec le concours de quelque opération « bwa kale » bien orientée en bamboche populaire, le tour serait joué et le chemin balisé pour le renouvellement du système sous des masques à peine repeints.
Avec le concours assidu, actif et intéressé d’une bonne partie de la presse, a fini par s’imposer le récit qui fait de la mésentente atavique entre les Haïtiens, la principale cause de la crise pluri dimensionnelle qui a amené l’effondrement du pays. La solution miracle trouvée traduit le degré de pertinence de l’analyse. L’imposition d’un conseil présidentiel nanocéphale sensé signifier l’harmonie retrouvée des principaux protagonistes. Sa principale tâche, dont la ratification conditionne le choix des membres, est pourtant non pas de montrer que leur entente amène la fin de la crise mais d’inviter une force étrangère à la résoudre à leur place.
Sauf à considérer qu’à coté de l’hypothétique démantèlement des gangs, les troupes étrangères ont pour principale fonction de veiller sur l’accord trouvé entre les Haïtiens, il est difficile d’écarter le caractère déterminant d’une cause transnationale derrière tout cet échafaudage.
Quand le local défie le global
Le prix du scalpe des chefs de gang suggère assez clairement que l’empire est loin de les considérer comme des petits caïds locaux. On ne connait pas le chiffre d’affaires de ces entrepreneurs de violence criminelle, mais le prix offert pour leur capture laisse supposer qu’ils brassent un business florissant, à même de les placer au niveau des oligarques contre lesquels ils se contentent de vociférer en guise de caution idéologique.
D’aucuns restent dubitatifs face à ce qui apparait, soit une certaine tolérance de l’empire vis-à-vis de ce phénomène ou du moins, ce qui serait encore plus étrange, de son incapacité à l’éradiquer. Comment expliquer en effet ce défi persistant lancé à l’hyper-puissance étasunienne dans sa propre arrière-cour, dans un contexte international si fragile, par quelques chefs de bande sans soutien d’aucune puissance rivale même de second rang ?
Les gangs ne seraient donc que la petite pointe émergée d’un iceberg dont les profondes ramifications impliquant des forces occultes (pas nécessairement vaudou) bien réelles expliqueraient à la fois leur intouchabilité et le flux intarissable d’armes et de munitions qui les alimente. Et nos chers conseillers présidentiels, un écran de fumée plus ou moins consentant à fin de prolonger le plaisir, un faire-valoir pour octroyer un semblant de légitimité à l’inacceptable.
[1] Le Point.fr : « La mafia, dealer de la démocratie » Interview avec Jacques de Saint-Victor autour de son ouvrage « Un pouvoir invisible. Gallimard, 2012. »
[2] National Democratic Institute.
[3] « La principale vertu des élections, celle qui justifie à elle seule que nous y tenions tant, se trouve ailleurs : les élections nous permettent […] de gérer les divers conflits qui peuvent exister au sein d’une société, tout en maintenant une liberté et une paix civile relatives. » ‘’A quoi bon voter ?’’
[4] Jacques Drillon, Publié le 15 juillet 2016 à 11h02 NOUVELOBS,
[5] Jacques de Saint-Victor Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique (Gallimard. Collection L’esprit de la Cité, 411 p.
[6] La mafia et la Maison-Blanche éditions Plon, 2024.
Reader's opinions
Continue reading


 Radyo Makandal Sove
Radyo Makandal Sove